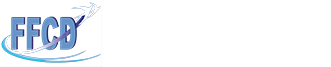Marie Muller, entre rigueur et bienveillance : l’itinéraire d’une éclaireuse en cancérologie
À 36 ans, Marie Muller, incarne une nouvelle génération de médecins engagés, alliant pratique clinique, recherche, enseignement et humanité dans un domaine en constante évolution Le portrait d’une femme de terrain, entre rigueur scientifique et écoute attentive.
Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a motivée à devenir oncologue ?
« Soigner », c’est un mot d’enfant devenu ma boussole professionnelle. Issue d’aucune lignée médicale, j’ai néanmoins toujours voulu être médecin. En découvrant l’oncologie, j’ai été attirée par cette spécialité en constante évolution, transversale, et portée par l’innovation. La cancérologie digestive, en particulier, était en pleine transformation à la fin de mon internat, il y a une dizaine d’années. J’ai choisi de m’y consacrer car elle se complexifiait, notamment avec des défis comme ceux liés au cancer du pancréas.
Vous êtes aussi onco-généticienne : pouvez-vous préciser cette spécialisation ?
J’ai en effet suivi un master européen en génétique pour maîtriser la génétique germinale et somatique. L’oncogénétique me passionne car elle permet d’agir avant que la maladie ne se déclare. C’est une discipline d’espoir. J’ai alors mis en place une consultation dédiée aux syndromes de prédisposition aux cancers digestifs, souvent sous-diagnostiqués. Ces consultations permettent de comprendre l’origine de certains cancers précoces, alors que nous voyons de plus en plus de patients jeunes, mais aussi de personnaliser les traitements, de dépister les proches et de rompre avec la fatalité. C’est cette dimension profondément humaine et proactive de l’oncogénétique qui m’anime : offrir aux patients les clés pour anticiper, comprendre et agir.
Votre centre a été nommé meilleur inclueur de patients pour les essais FFCDen 2024 : comment avez-vous atteint ce résultat ?
En arrivant, j’ai voulu redonner un souffle à la cancérologie digestive à Nancy, où elle était peu développée. J’ai été soutenue par la FFCD, qui m’a guidée dans l’ouverture de nos premiers essais cliniques. Il est essentiel de parler de ces essais avec les patients, de leur en expliquer clairement les objectifs et le cadre. Ce dialogue favorise leur adhésion, car la majorité comprend l’intérêt de cette démarche. Il faut aussi sensibiliser les équipes, instaurer une culture de la recherche au quotidien, et avoir une vision collective à long terme.
Quels sont vos autres engagements dans des structures professionnelles et associatives ?
L’information est pour moi un levier essentiel. J’intègre cette dimension dans chaque consultation pour briser l’isolement des patients. Arrivée à Nancy, j’ai constaté une absence de structuration locale en oncologie digestive. J’ai donc noué des partenariats avec ESPOIR Pancréas et plus récemment ESPOIR Voies Biliaires. Je collabore aussi avec ARCAD, qui propose des ressources claires et accessibles, comme des webinaires sur la recherche ou les effets secondaires. Cela crée une relation renforcée avec les patients.
Vous avez développé la télé-expertise pour l’oncologie digestive : en quoi cela consiste ?
Face à la raréfaction de la dermatologie médicale, la télé-expertise s’est rapidement imposée comme une solution au CHRU de Nancy ; j’ai voulu adapter cette initiative à la cancérologie digestive. La cancérologie devient de plus en plus complexe et progresse très vite. J’ai la chance de pouvoir me concentrer uniquement sur la cancérologie digestive. Mais ce n’est pas le cas dans les structures périphériques, où il n’y a pas de spécialistes dédiés. On y trouve surtout des oncologues « généralistes », qui ne peuvent pas tout maîtriser. Grâce à cette télé-expertise, je peux leur apporter un soutien concret : les aider dans les prescriptions, les stratégies thérapeutiques, et renforcer ainsi la prise en charge sur l’ensemble du territoire du Grand Est. Et puis, très concrètement, ouvrir un canal de télé-expertise a aussi considérablement simplifié la communication et a favorisé une coopération immédiate.
Quelles évolutions observez-vous concernant les cancers digestifs ?
Nous constatons d’abord une augmentation significative du nombre de prises en charge, notamment en ce qui concerne les cancers digestifs, dont l’incidence explose. Cette tendance reflète toutefois une évolution attendue dans une population qui vieillit progressivement : le cancer reste, en grande partie, une maladie liée au vieillissement. Un autre phénomène même s’il ne constitue pas la majorité de nos consultations : la prise en charge de patients de plus en plus jeunes. Face à ces deux tendances, nos capacités d’accueil en chimiothérapie ne sont pas extensibles, et nous manquons de médecins pour répondre aux demandes croissantes.
Quel(s) message(s) souhaiteriez-vous faire passer aux plus jeunes encore étudiants en médecine pour qu’ils s’engagent dans la voie de la cancérologie digestive ?
La cancérologie digestive est encore boudée. C’est une spécialité lourde, chronophage, avec des consultations longues et complexes. Elle peut faire peur. Pourtant, elle est aussi passionnante. La relation humaine y est profonde, les avancées médicales nombreuses. Il faut oser s’y engager ! Plus nous serons nombreux, plus nous allégerons cette charge, et plus le travail en équipe prendra tout son sens.
À titre personnel, quels sont vos plaisirs nécessaires ?
Quand j’ai du temps, je vais à l’essentiel : être avec mes proches. C’est mon socle. J’adore aussi flâner en librairie, sans but précis, me laisser happer par un livre. Et puis je voyage. Une ou deux fois par an, je pars randonner dans des coins reculés. Ces pauses me sont vitales : elles me ressourcent et me permettent de faire le vide pour mieux revenir.